|
agonia francais v3 |
Agonia.Net | Règles | Mission | Contact | Inscris-toi | ||||
|
|
| |||||
| Article Communautés Concours Essai Multimédia Personnelles Poèmes Presse Prose _QUOTE Scénario Spécial | ||||||
 |
|
|||||
|
agonia 
■ De la dissolution de la démocratie dans la ploutocratie
Romanian Spell-Checker Contact |
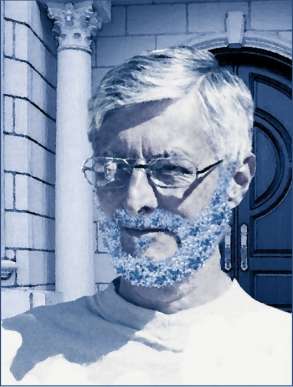
- - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2016-05-06 | | Je suis né dans une église, c’est certain ! D’ailleurs, ma charmante épouse me le confirme avec une certaine régularité, elle m’en fait gentiment la remarque, à moi pauvre lutin (natif de Luc-sur-Mer) qui ne ferme jamais ses portes derrière lui, au grand bonheur des mots et des fantômes, des Anges et des courants d’air. Être né dans une église est pour moi très flatteur ! Soit, je suis bien né dans une église et bien c’est vrai, j’ai une sainte horreur des portes fermées, des culs-de-sac et des pièces qui manquent d’air frais, j'ai horreur des écailles comme des croûtes sur les yeux, des bouchons dans les oreilles, des bouches qui s’autocensurent et de tous ces accès bouchés à l’émeri ou au ciment. Il en est ainsi des labyrinthes et des prisons, des impasses, des impairs et de tout ce qui manque d’ouverture ! Je déteste la fermeté des fermetures, la résistance des manques d’égards et d’amour, la rigidité des hommes et des volets clos qui gardent le regard fermé à double tour. Je vomis les espaces clos comme les barbelés et les murs de séparation ; j’exècre corps et âme les chambres à part ; les enfermements et les blocages ; les bâillons et les œillères qui obstruent des chemins incertains aux idylliques perspectives. Ave célestes ouvertures ! Ave firmaments ouverts aux étoiles ! Ave Champs Elysées expansifs comme d’incommensurables horizons, Ave … Je désire de l’air, l’air de la paix et la paix de l’air comme la carpe aspire à l’eau ; de l’air renouvelé comme de nouvelles pensées. Ave ! Je suis pneumatique et j’aspire au verbe être comme aux vents des quatres horizons ; ne suis-je pas la bise qui passe de joie en joue, le Zéphyr qui saute de crique en lagune, et ricoche d’île en plage, tout comme l’opium donne de l’air aux visions et souffle des bourrasques qui emportent la douleur au loin. Je n’aime guère les arts ou les livres qui sentent la norme, la mode ou le renfermé. C’est exact, j’ai besoin d’air et de souffle frais, j’ai soif de liberté,de voiles ou d’ailes et de vents, d’espaces aériens où le bleu est comme un ciel serein peint par Magritte ; j’ai faim d’au-delà et d’ailleurs, d’ascension et d’assomption possibles ; je n’aime guère les séquestrations économiques, politiques ou religieuses ; les chaines et les fers de l’esclavage, ainsi que les ferrures de toutes les formes de serrures ; les clefs et les verrous ; les cadenas qui verrouillent les sens et les relations. Je déteste de tout mon être les portes et les cœurs blindés, les loquets qui barrent le passage ; les pierres et briques qui condamnent les ouvertures ; les barreaux de prison et les cages à oiseaux qui empêchent de passer ou plus encore de voler de son propre zèle. Oui, j’ai une forte répulsion et même une forme d'appréhension de tous les instants pour tout ce qui pourrait être fermé à tout jamais ; comme une profonde crainte viscérale pour les volets et les rideaux de la création ; pour les multiples muselières et toutes les censures de tous les clausoirs de la liberté de penser et de s’exprimer. Si effectivement, je suis né dans une église, alors, elle était une sorte de temple ouvert aux quatre vents ; comme une traversée de lumière, un chœur béant comme une baie donnant sur la forêt, la montagne ou l’océan. Une chapelle sans mur, une église sans contrainte, paradoxalement enclavée de vides, tels un grand vertige de liberté sans obligation, un émerveillement sans clôture et sans cloître. C’était surement ça, une église pleine d’espace et d’espérance, une claire-voie donnant sur un infini sans limites et sans dogme, dans une fine enveloppe d’amour transparente pour chacun et ouverte à tous. Et pourtant… Je suis Le Barde Bleu d’une exoplanète, comme un autre moi-même en-dehors de moi, comme le fruit blet des amours d’une Barbie qui avait oublié sa pilule de la veille, et d’un Spider Man sous l’effet des anabolisants. Pataphysicien de la dernière heure, certes, je suis bien né dans une église en spirale ouverte au Cosmos et au Verbe comme la Gidouille d’Ubu, et même né de nouveau et plusieurs fois encore et encore, dans d’autres chapelles, d’autres cathédrales ou bien d’autres basiliques d’Orient ou d’Occident. Des églises réformées, peut-être bien, mais jamais refermées ! Des chapelles Latines, avec des oratoires comme des laboratoires, probablement, mais jamais closes comme des latrines – des églises aux girons éventés comme éventrés pour engendrer la vie ; des paroissiales à taille humaine et de majestueuses abbayes bien accueillantes, avec des jardins entrebâillés sur le monde, des vitraux béants de lumière, là où peuvent s’élever les âmes et les cœurs comme la flamme rouge des lumignons et la fumée des encensoirs. Des églises, peut-être, mais avant tout des lieux de tendresse et de pardon, avec de la fraternité, de la fraîcheur, de la paix et un silence bon comme le pain bénit. Comme Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire dans le Morvan où pour la première fois j’appris à communiquer sans utiliser les mots – ou alors, comme le monastère de Notre-Dame des Voirons à noël 1967, où sous une épaisse couette de neige je découvrais le vrai silence. Des églises ouvertes, telles des balises éternelles, des lieux bénis, sacrés ... Il en fut ainsi depuis ma prime enfance, de Notre-Dame de La Délivrande (Douvres) où je fus consacré à l’âge d’un an, jusqu’à Notre-Dame-des-Anges (Clichy-sous-Bois) où je fis ma grande Communion et ma Confirmation ; de Notre-Dame du Raincy où j’étais au collège Notre-Dame, jusqu’à Notre-Dame-d’Espérance de Charleville-Mézières où j’aime aller écrire et méditer à l’ombre de la vie; en passant par N.Dame de Chartres avec ses vitraux bleus, et Notre-Dame d’Amiens... Je suis non seulement né dans une chapelle, mais je suis moi-même un petit temple de l’esprit ! Je suis Le Barde Bleu des champs et des villes, au profil barbelé comme un Christ couronné d’épines – Je suis la Vénus de mille eaux aux couleurs de la Manche, là où la Côte se fait Nacre comme celle d’Adam se fit femme ; là où le sable à l’odeur forte du varech, et où à marée haute les flots me parlent de mes origines marines. Notre-Dame, telle l’étoile de la mer de Charles Péguy, « ô reine de douleur » soit mon guide dans la nuit. Pierre Corneille dans un élan mystique ne disait-il pas : « Homme, qui que tu sois, regarde Ève et Marie ». Poète ou pas, entre l’Ève qui m’engendra et La Tout-Autre inaccessible et inconnaissable, j’écris mon propre chemin d’espérance, et avec Paul Verlaine qui en Sagesse demandait conseil à cette « Porte du ciel » j’ouvre mes oreilles et mon cœur à toute suggestion de la Mer, du Ciel et de la Terre. Notre-Dame, je suis là moi-même devant toi dans toute ma triste et pauvre nudité de poète, tel un barde sans voix et sans parure, sans pureté et sans ornement en dehors de mes pauvres mots. Alors, quand j’aurais fini de jouer de toutes mes croyances erronées, de toutes mes vaines idéologies et de toutes mes identités fictives… je ne te demanderais qu’une chose, une seule, laisser la porte ouverte. À toi N.D., refuge des poètes, rien qu’une petite porte entrouverte ! Je suis un « lutin » fier de l’être, comme je suis ma propre mémoire et mon gros lot de souvenirs qui carillonnent comme les cloches des vaches qui broutent paisiblement dans les bocages de ma tête, couleurs d’alpages au cœur de notre Suisse normande. Les souvenirs d'enfance affluent en moi comme le lait abondant d’une inépuisable nourrice. Derrière la porte close, c’est le sein des seins, il faut l’ouvrir, absolument, car on ne fait pas d'Œdipe sans tuer le père Noël, et pas d'Hamlet sans casser d’œuf, c’est la vie, c’est ainsi, soit-il, la vie psychique soit-elle, où deux par deux les choses reviennent comme les Témoins de Jéhovah avec toute la même détermination et toute l’amplitude des pulsations cardiaques d’un car jacker volant une petite voiture Dinky Toys, en 2070 dans un supermarché galactique. Parce que nous sommes toujours tiraillés entre le passé simple et le futur complexe ! Je suis sur roulette russe, un caddy plein de mots ; hagard comme un éléphant rose sans défense dans un magasin de porcelets sous haute surveillance. Je donne l’impression de courir, car j’ai des hackers sprinters à mes trousses, des hackers coureurs de fond qui ne cessent de triturer ma mémoire vive… Ce qui me donne des migraines épouvantables et de grands martèlements de temp (e) s, comme quand on se met soi-même martel en tête à coups de fantasmes pour passer la douane, avec des rêves pleins ces bagages, des rêves gros comme les montgolfières du château de Balleroy, là où ma propre mère est née en 1921. Car je suis un Barde bleu, un nomade normand, un migrant noué comme un nœud gordien. Et quand la migraine frise l’horizon avec un fer chaud pour boucler les vagues, je deviens moi-même étrille sur une plage avec vue sur terre. Oui, l’air de rien, les souvenirs reviennent à la charge et remontent à la surface de mes méninges, avec un bruit sourd, comme des bulles d’air dans un jacuzzi hydromassants, comme des mains de sirènes sur ma peau fripée; faisant sur ma personne des plis et des rides profondes tels des remous de mémoire, des lignes calligraphiées sur du papier -sillon comme un vieux vinyle sur lequel mon père chante, comme chaque année, « Minuit Chrétien ». La mémoire est photographique autant qu’elle est phonographique, c’est ainsi que les enregistrements se suivent et ne se ressemblent pas. Il faut le vivre pour le croire, je suis le barde bleu et sujet de séismes de l’âme et l’objet de tremblements de main probablement impossibles à caser sur l'échelle de Richter, mais pouvant être mesurés sur l’échelle de Jacob. Entre de grandes magnitudes et de fortes amplitudes spirituelles, la vie se déploie, entre la vie, l’amour et la mort, le haut et le bas, l’extérieur et l’intériorité… comme dans un récit, un double de la stupeur et des tremblements d’Amélie Nothomb, ce qui ressemble à de petits tsunamis de ventre ou à de moindres raz de marée de tête - ce qui provoque en moi la nausée, et peut-être même chez vous aussi, avec des perceptions extra-sensorielles, des états modifiés de confiance, de grands « et moi » « et vous » comme des flux de pensées qui roulent comme sur un billard américain entre « Je » et « Tu », entre celui qui écrit et ceux qui lisent. Avec mon sac à billes cousu par ma mère l’Oie, je suis le vilain petit canard. Les yeux grands ouverts comme des globes de verre colorés, les billes roulent dans un long kaléidoscope vers les trous noirs de l’oubli. La vie roule ainsi, la bile blanche dans un grand trou noir, et la bille noire dans un grand chou blanc. La moralité de l’histoire c’est que la bile et la bille roulent dans le même sens. La vie, l’amour et la mort sont des jeux de société, comme les jeux de Dada, de Nain jaune ou de l'oie… Enfant, sur le parquet de chêne en chevrons de la salle à manger, pour aller jouer autour de la table familiale, nous marchions avec des patins comme des manchots empereurs sur une banquise lustrée. Aujourd’hui encore, je marche sur la pointe de la plume, sans faire le moindre bruit avec le même sang d’encre, en me souvenant du temps où j’étais un véritable goéland. Sur la table de bridge marquetée avec ses tiroirs secrets pour les cartes à jouer et son plateau tournant tel celui d’un spirite, mon père nous initiait au jeu d’échecs. Ainsi, comme dans des images mythiques ou même bibliques, au fil des weekends et des vacances, sur l’échiquier des jours, la vie opposait le père et ses fils, le frère contre le frère… pour jouer aux jeux compliqués de la vie. Depuis ce temps, j’ai dans la tête un plateau compact, celui d’une table de bridge en marqueterie, composée de soixante-quatre cases blanches et noires sur lesquelles je migre… C’est un plateau de « Je » aux « enjeux » innombrables, avec son sablier en guise de pendule pour décompter le temps. C’est avec les calots métalliques de roulements à billes que mon père ramenait de l’usine que je jouais aux billes. Elles roulent lourdement sur le sol de la Dhuis, lançant des reflets métalliques, ceux de l’acier bien poli. Nous sommes à Clichy-sous-Bois avant 1960, avant le choc des cultures ; avant le retour des pieds-noirs en région parisienne, bien avant que poussent les HLM champignons sur ce qui restait alors de la forêt de Bondy. Dans les souvenirs je plonge, c’est “le trou normand”, comme des planètes folles, les 16 boules glissent vers les six trous noirs – tels un flot d’hormones tièdes qui me traverse, un flux de mémoire, de réminiscences explosives comme l’essence dans un moteur à souvenirs. Du haut de la rive droite de la Souleuvre, à proximité de Ferrière entre Caen et Vire, entre le Ciel et la Terre, la tête et le ventre, l’extérieur et l’intériorité … équilibriste sur le fil des mots, funambule fou, funambule de Dieu, je saute à l'élastique, au-dedans de moi-même je saute, comme au bout de bretelles extensibles à l’infini. Du haut de mes septante ans et des 60 mètres qui me séparent de mes souvenirs et de la rivière que je surplombe comme un géant qui regarde ses pieds d’argile, je sursaute ! Mais ce n’est qu’un rêve ! Enfants déjà, en vacances nous venions là pique-niquer en famille, piquant du nez sur le fond de la vallée, cultivant le vertige du haut de nos dix ans. Oui, bien avant 1970, avant que le pont Eiffel ne soit démonté. Vous l’ignorez probablement, croyant davantage au jeu de mots et aux effets de style comme le charbonnier croit aux miracles, mais vous vous trompez certainement ! Comme le saut à l’élastique, la poésie est elle-même un art difficile, plus qu’un simple sport, c’est une activité extrême à sensations fortes ou excessives. Au-dessus des vides, des mots et des pages blanches, la poésie, c’est un gouffre ! Tout ça pour tenter désespérément de dire quelque chose du Réel. Tous ces mots pour prendre le risque de tendre à l’essentiel ; Car la simple réalité ne peut satisfaire le poète, il lui faut creuser davantage la réalité de la réalité avec ses ongles, à coup de métaphores comme le mineur cherche le minerai précieux ; il lui faut évider les évidences, sauter dans le vide et l’inconnaissance pour y cultiver le doute le plus ténébreux et faire jaillir ainsi du sol les lumières les plus éblouissantes ; telles des pépites de mot plus dorées qu’une icône ou qu’une statue de Bouddha. Sachez-le, malgré les apparences, on écrit avec de l’adrénaline et pas avec un clavier d’ordinateur ! « Ceci n’est pas de l’encre » dirait Magritte, mais du sang et du sens ! Ceci n’est pas un Word, mais un cri primal ou un souffle vital. En poésie comme dans un no man’s land miné, il y a toujours du danger, d’énormes crevasses, des béances comme des trous de bombe et même des grenades à retardements, des illusions nombreuses et un tas de faux-culs pour vous faire abandonner la Quête, l’aventure intérieure, le pèlerinage aux sources. La poésie, c’est comme un saut en parachute libre, comme un marathon sur des sables mouvants ; un parcours de moto-cross entre les mots qui manquent et les phrases inapaisables ; c’est une escalade à pic au-dessus du papier cru, comme un raid nature où toute la nature voudrait reprendre toute sa place. Écrire de la poésie, c’est comme de se promener avec un gilet explosif toujours prêt à éclater ou comme un désir disposé à imploser. La poésie, c’est un état de semi-débauche de mots plus ou moins corrompus ; au péril des lignes, c’est un piège à mot prêt à se refermer sur vous ; une oubliette, une somme d’embûches, tel un coupe-gorge, là juste au coin de la reconnaissance, de l’académie ; vous avez beau vous protéger, battre en retraite ou crier « au loup », la poésie sans cesse vous rattrape, car elle est dépendante de vous ; le poète paie toujours de sa personne les mots qu’il emploie, car en vérité, ce sont les mots qui emploient le poète. Pas question ici de courir sa chance, de tenter les anges, le poète dès le départ est un malchanceux ! alors, seuls le grand écart, le saut périlleux, l’expérience extrême peut l’aider à avancer, même s’il risque gros, même s’il écrit à fonds perdu, même si l’épée de Damoclès le menace ; même si le papier est brûlant comme les lèvres de l’enfer, le poète ne peut qu’écrire au risque de la vitesse de pointe, de la hauteur vertigineuse, de la plongée libre ; écrire en écumant les mots en évitant les écueils, comme celui qui ferait du delta-plane ou du parapente au fil de sa cursive, tout ça simplement parce que la poésie reste une impossible équipée, une intrépide spéléologie au cœur de l’inconscient, une échappée doublée d’une aventure du cœur au cœur du monde. Alors, il lui faut continuer à écrire en parcourant la coursive de sa cursive, avec toute l’audace d’un alpiniste qui se jouerait du vide total, comme en situation d’écriture automatique ou comme dans une sorte de poésie acrobatique pleine de mille périls. Sur mer, sur terre ou dans l’air, la poésie comme la littérature n’est pas un divertissement, loin de là, et encore moins un violon d’Ingres ! Elle engage véritablement, elle hypothèque tout l’être de celui ou de ceux qui osent s’y exposer comme au feu du soleil : moralement, psychologiquement et physiquement, allant même jusqu’à leur brûler les ailes, en attirant les coups du sort ou en provoquant les échecs au Roi. Appâté moi-même, pas à pas (appât), mot à maux, je sais les dangers de l’écriture ! En fonction de la vitesse d’action et de réaction, ou de la hauteur des ambitions, elle peut provoquer toute sorte de déboires, de lourdes déceptions, et même de profondes blessures narcissiques... Pour ma part, né de la semence d’un survivant des camps de la mort, je n’ai peut-être pas de sang bleu, mais j’ai de la sève de bouleau qui coule dans mes veines et traverse les grandes artères des mégapoles où j’écris dangereusement. J’ai pareillement la main verte de ceux qui mangent des algues bleues et brunes. J’ai du corail au fond des pupilles et le regard des grands oiseaux de mer. Ce qui, entre nous, ne me donne aucun avantage ! Entre la scène des souvenirs et le théâtre onirique, mille scènes me reviennent à l’esprit comme des fantômes diaphanes. Mon frère Jacques, de cinq ans mon aîné a peur du noir – alors, il me demande de me lever de mon lit et d’aller allumer la lumière. À côté, dans la chambre des parents, il y a du bruit, c’est là que se jouent toutes les scènes dites primitives, les scènes dites originaires et l’énigme des mots d’amours, des souffles rapides, des relations entre les grands et les parents. La poésie, c’est pareil, on est toujours derrière une porte, au bout d’un escalier dessiné par M.C. Escher – avec des paliers pleins d’autres portes, dans d’impossibles constructions des mots de brique, de montées et de descentes constamment paradoxales. Il vous faut écrire à la lumière des mers phosphorescentes dans des miroirs sans cesse déformés et déformants, avec des rêves plus réels que la réalité, des visions tortueuses à l’intersection de l’imaginaire et du symbolique, la plume ou le clavier comme emporté par le tourbillon des métamorphoses. Écrire de la poésie, c’est marcher dans un ruban de Moebius où l’on revient toujours à son point de départ, avec en soi l’image d’un autre monde derrière chaque porte, derrière mille portes qu’il nous faut ouvrir en cascade éprouvante. Vous voyez bien que la poésie n’est pas une simple évasion, une fuite en rimes, ou alors c’est qu’elle relève davantage de « La grande évasion », celle qui vous vide, qui vous extrait de vous-même comme une totale dépossession, avec au bout de la main le manque et au ventre cette faim qui vous exproprie sans cesse dans des ailleurs. « Ma faim, Anne, Anne, Fuis sur ton âne. » (A. Rimbaud – Fêtes de la faim). Attention aux yeux ! Mes yeux ont tellement vu, vu au passé composé comme ils ont vu au présent décomposé ; ils ont tellement cru aux miracles et tellement vu d’illusions, tellement lu aussi, qu’ils en sont devenus comme de vieilles peaux parcheminées ; formellement et fondamentalement, dans la forme et dans le fond, âme, mon âme ne vois-tu rien venir ? Ne vois-tu rien qui puisse me libérer ce cette onction ? Il était une fois ... et j’ouvre une nouvelle porte en moi. Comme Le Barbe bleue, je suis de la race maudite des Cagots, celle des éternels migrants, je suis du côté des Arméniens, des pieds-noirs, des juifs, des exclus et de tous les immigrés... A l'inverse des contes, je n’ai point « de belles maisons à la ville et à la campagne », point de « vaisselle d’or et d’argent, des meubles en broderie, et des carrosses tout dorés ». Mais par malheur, j’ai la barbe en fleurs et cela me rend champêtre et poétique. Mais ce n’est qu’une apparence, une triste réalité… Ce qui est laid et terrible dans ma vie et cette histoire en particulier, ce n’est pas mon profil poétique et ma barbe bleue, c’est le poids des mots, ceux qui ne cessent de me demander en mariage … un mariage noir comme l’ébène d’une esclave de rêve. La poésie, ce n’est pas une promenade idyllique, une partie de beaux mots et de vers rutilants pour l’oreille ; ce n’est pas que du rire, de la rime et de la réjouissance comme un grand festin de lumières et de belles images qui coulent de source et sentent la rose. En poésie comme en religion ou en politique, ce qui est terrible, c’est d’être soi-même la clef de soi, pas la clé de sol ou de fa qui ouvrent quelque agréable symphonie, mais d’être « cette petite clef-ci », comme le raconte Perrault dans Le Barbe bleue ; celle qui ouvre à l’intériorité, au Saint des Saints, celui qui se trouve derrière chaque porte, chaque escalier, chaque palier… « Au bout de la grande galerie de l’appartement bas ». L’appartement « bas », là où tout semble normal au commun des mortels, mais où le sang se change en encre comme l’eau en vin, par quelque processus alchimique ou mieux encore par celui d’une heureuse transsubstantiation littéraire. Quand vous descendez en vous par des chemins escarpés et des escaliers dérobés, porte après porte, jusqu’au seuil du fameux « cabinet », là où la tentation est si forte qu’il vous faut écrire et écrire encore, ouvrant les portes une à une, les fenêtre les unes après les autres, les mots, les uns après les autres… jusqu’à percevoir à travers le plancher et les murs, là où dorment d’un sommeil profond vos fantômes et vos secrets anciens, ces vérités sur vous-mêmes surtout, des vérités caillées par le temps, des libertés conditionnelles érodées par les larmes, des souvenirs morts d’avoir été oubliés, des mots rouillés d’avoir été si peu utilisés, ainsi que nombre de sentiments et d’émotions refoulées ; car la clef de Barbe bleue « était fée » (Perrault) comme le poète est « fait » jusqu’à la chair de sa chair, jusqu’à l’os des maux, et « fait » et « refait » jusqu’à la moelle des mots , couvert de mots comme de sang et de sève, couvert de sang comme de sens, couvert de peur au point de penser mourir en écoutant cette voix intérieure qui lui dit sans compassion : « Hé bien, vous avez voulu entrer dans le cabinet » Et bien écrivez maintenant ! comme dans un conte de Perrault ou une fable de Monsieur de La Fontaine ! Alors, vous aurez beau vous jeter à terre pour lécher les pieds des muses, en pleurant toutes les larmes de votre corps défait, et dire tous les vers en rime que le monde puisse contenir, rien n’y fait, vous être « fait » et « refait ». Faits et geste vous n’avez plus qu’à reprendre la plume comme on prend le chemin de l’exil. Même en demandant pardon comme on demande l’aumône, « avec toutes les marques d’un vrai repentir de n’avoir pas été obéissant(e) » (Perrault) Rien n’y fait… rien de rien, vous être « fait » et « refait » encore et toujours... Car La Poésie, il faut l’expérimenter, est une maîtresse femme dangereuse, un vrai maître au cœur dur comme le diamant ; vous vouliez écrire, alors il vous faut écrire maintenant ! Vous aurez beau crier de tout votre cœur : « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » cela ne servira à rien et surtout pas la poésie ! Celui qui ne voit que « le soleil qui poudroie, et l’herbe qui verdoie » se dit peut-être « poète », certes, à sa manière, il l’est un peu, cependant la main qui écrit n’est pas forcément celle qui libère, et les mots rédigés ne sont pas nécessairement ceux qui ouvrent les portes. La moralité de cette histoire, c’est que la poésie n’est pas du tout l’Univers enchanté de Disneyland, mais que bien son contraire, elle se relève bien souvent comme un univers dantesque, un monde ténébreux à l’instar de celui de Mirbeau ou d’Artaud, c’est là même l’univers d’un Lautréamont ou d’un Rimbaud… Un jardin des supplices, une folie en quelque sorte ! « Quand on creuse le caca de l’être et de son langage, il faut que le poème sente mauvais » (A. Artaud - Lettre de Rodez) C’est ça une poésie, une écriture qui, à l’instar du théâtre d’Artaud est « Un théâtre de sang » qui « vise à la transformation organique et physique…» , une profonde métamorphose, une mue de l’âme … C’est comme au cirque, certains poètes peuvent se contenter d’être des amuseurs « pudiques », et très souvent même « publics » et médiatisés, au lieu d’être les ennemis publics, ceux qui écrivent d’immondes ou impossibles vérités pour libérer la parole et la vie, des sujets aux objets de discorde. La poésie est un engagement de tout l’être, pour la liberté et la vérité. Dans l’arène, du monde, être dresseur et aligneur de mots et de belles histoires ne suffit pas, il faut être montreur de maux et redresseur de torts. À travers un passé composé et un présent décomposé, il faut tendre toujours plus à un futur possible. C’est quand les mots frisent la mort qu’ils engendrent la vie et l’amour. L’écriture sublime, c’est le talent sublimé, c’est cette conscience du danger présent et de la mort toujours possible. La poésie veut qu’on lui sacrifie tout et surtout jusqu’à son dernier talent ! Tout comme je hais les portes fermées, la poésie abomine les troubadours à l’eau de rose, ceux qui écrivent pour la gloire ou pour Communale - ces clowns jongleurs de mots qui ne sont que des clones de versificateur et d’illustres manipulateurs, les flatteurs vivant et profitant bien de ceux qui les écoutent. Comme discipline dangereuse, la poésie est aérienne et acrobatique. Sur la piste du cirque littéraire, il nous faudrait passer de la poésie équestre pour bourgeois dresseurs de dictionnaires à cette douloureuse itinérance qui exclut de son siège toute forme d’immortalité. L’écriture est donc comme une « métamorphose » kafkaïenne, elle est à la métamorphose ce que la métaphore est à la réalité, un impossible chemin qu’il nous faut quand même prendre, faute de Réel ! L’acte poétique dont je parle est par excellence un « engagement » de chaque instant, loin des cercles et des écoles. Tout comme la vie, la mort ou l’amour, on vit la poésie comme une métamorphose de soi-même, on ne joue pas de la poésie comme du saxophone, on ne jouit pas de la poésie comme d’un beau paysage, on s’engage à rester une porte ouverte pour soi-même ou les autres, ou l’on s’en va ! (…)
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| La maison de la litérature | |||||||||
 |
|
